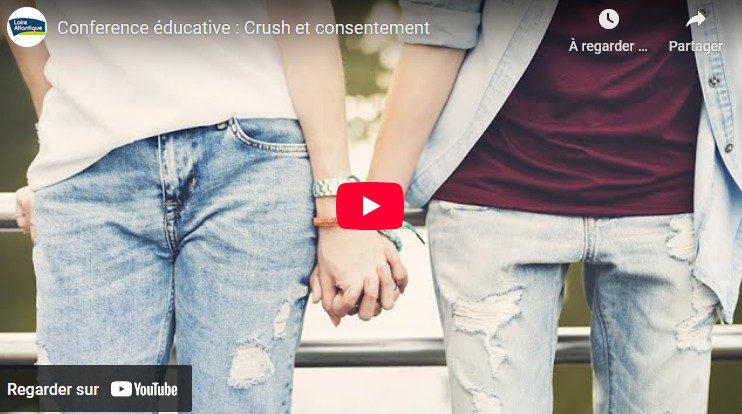Ceci est le contenu d’un article écrit par Camille Bouza pour Ouest France et publié le 20/07/25 :
Entretien. Éduquer à la vie sexuelle et affective, un essentiel pour «déconstruire les représentations»
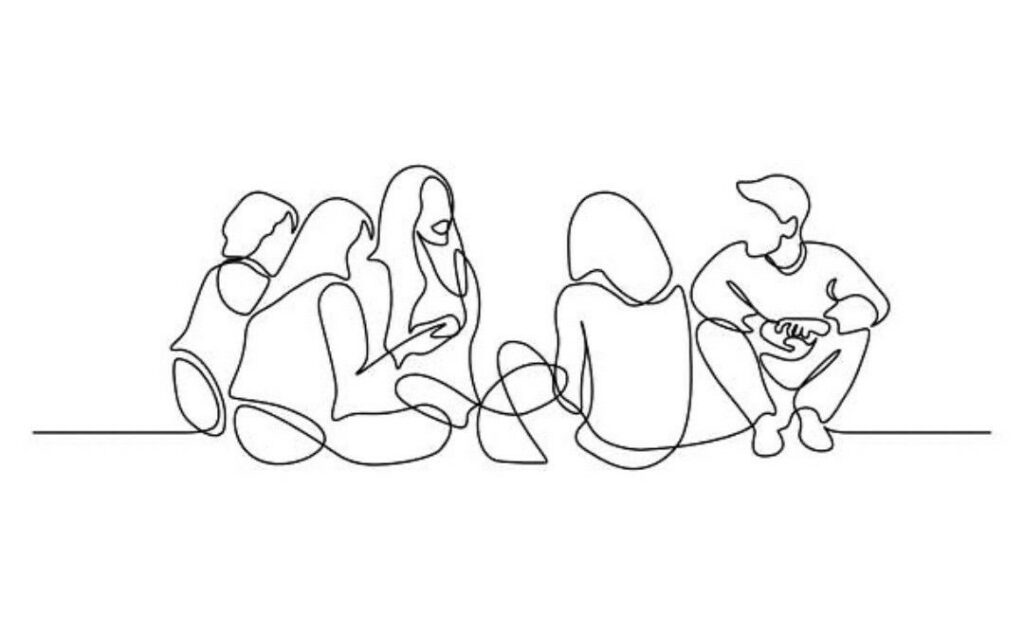
Parler de vie affective, relationnelle et sexuelle tout au long de la scolarité. L’idée n’est pas nouvelle. Elle est même obligatoire depuis 2001. Mais nouveauté à la rentrée septembre : le cycle éducatif va évoluer et devenir réellement concret. L’initiative vise à mieux accompagner les enfants et adolescents sur des sujets essentiels. Décryptage de ces enjeux avec Christine Détrez, sociologue, et Valentin Chevallier, conseiller conjugal et familial.
Certains ne voudraient l’évoquer que dans le cadre familial. D’autres la renvoyer aux calendes grecques en espérant que les questions trouveront seules des réponses, quand il ne s’agit pas de la nier tout simplement. Pourtant, la vie affective et sexuelle des adolescents existe. Elle possède ses propres codes et s’inscrit dans son époque, offrant différences et similarités avec celle des générations précédentes. Mais elle est aussi traversée par des stéréotypes, des non-dits, des craintes et des interrogations. De ces facteurs découlent la nécessité d’en parler, d’éduquer mais surtout d’écouter.
Dès la rentrée de septembre 2025, un nouveau programme autour de cette thématique sera déployé dans les établissements scolaires français. Les élèves du premier degré aborderont la vie affective et relationnelle. Ceux du second degré verront, en plus, l’éducation à la sexualité. Un apprentissage progressif mais nécessaire pour que chacune et chacun se sente à l’aise.
Reste que cet accompagnement pose légitimement des questions. Christine Détrez, sociologue et autrice de Crush : fragments du nouveau discours amoureux, et Valentin Chevallier, conseiller conjugal et familial à Nantes réalisant déjà ce type d’atelier auprès des élèves, ont accepté d’y répondre.
L’éducation à la vie sexuelle et affective à l’école va être renforcée dès septembre. Pourquoi est-ce important d’en parler ?
Christine Détrez : La vie affective et le rapport à la vie sexuelle sont traversés par des stéréotypes de genre qui sont eux-mêmes le corollaire de discriminations et de violences. Tout ceci a ensuite des effets sur la manière de vivre ensemble. C’est donc très important d’en parler dès la maternelle car il n’y a pas un âge où les stéréotypes éclosent comme des fleurs. Montrer le côté construit des discours stéréotypés – les garçons sont comme ci, les filles sont comme ça – permet d’éviter qu’ils agissent comme une seconde nature et donne confiance.
Valentin Chevallier :
L’idée est aussi de déconstruire certaines représentations assez caricaturales sur les minorités d’orientations sexuelles et d’identités de genre. Ce sont des sujets qu’ils ne connaissent pas bien. Mettre des mots dessus, c’est prévenir un risque d’hostilité acquis par le contact avec des discours adultes plutôt agressifs à l’égard de ces minorités.
On participe à ouvrir leur champ et à les mettre face à leurs contradictions. On leur montre que ces discours ne tiennent pas debout.
Concernant les plus petits, savoir nommer les parties du corps, les organes génitaux peut permettre de se prémunir d’éventuelles violences sexuelles. On apprend à se protéger soi-même car les adultes ne sont pas toujours en capacité de le faire ou bien attentionnés. Pour ceux plus âgés, il y a aussi ce qui tient de l’intime. Ils vivent d’énormes transformations sexuelles et corporelles, notamment à partir de la 6e. Il s’agit donc de les accompagner pour qu’ils puissent mettre des mots sur ce qu’il se passe en eux, mais aussi sur ce qu’ils voient, comme la pornographie par exemple. On travaille le vivre ensemble et le vivre avec soi. C’est un processus qui prend du temps.
Comment se caractérise la vie affective et sexuelle des adolescents ?
CD : Contrairement à ce qui peut parfois se dire, des travaux de sociologie ont montré
l’importance de la norme du couple. Lors d’entretiens, plutôt avec des lycéennes, certaines se demandaient si avoir un crush (un coup de cœur, NDLR) alors qu’elles étaient en couple ne s’apparentait pas à de la tromperie.
VC : Socialement, le couple signifie beaucoup mais ils ont toute une gradation, avec des étapes avant le couple qui y mèneront peut-être ou pas. La fidélité est aussi extrêmement importante et très rigide, notamment chez les collégiens.
CD : Le double standard fille-garçon reste aussi présent.
VC : Oui, mais pas avec les mêmes mots pour qualifier les personnes qui enchaînent les partenaires. Une fille sevoit toujours accoler le mot « pute » ou le qualificatif de « facile ». Pour les garçons, c’est aussi de moins en moins valorisé, le côté Don Juan a laissé la place à « charo ». Ce terme renvoie à charognard, un animal qui mange de la viande déjà morte. Si on suit cette logique, une femme qui se laisse avoir par un « charo », l’hétérosexualité étant encore la norme, ce n’est qu’un cadavre, quelqu’un dont on peut user et abuser.
De la même manière, il y a aussi le terme bodycount. Au départ, c’est un terme désignant le nombre de morts sur une scène de guerre, une catastrophe. Il désigne maintenant le nombre de partenaires sexuels. Il y a quelque chose autour de la mort et cette idée est extrêmement perturbante.
Donc ce sont encore les femmes et les filles qui se retrouvent dans la position la plus péjorative ?
VC : Les filles sont perdantes quoiqu’il arrive. Et dans les classes, ce sont elles que l’on entend le moins.
CD : Il faut aussi s’intéresser à ceux qui n’utilisent pas ce terme. Un groupe d’étudiants a travaillé sur le forum JeuxVidéo.com et notamment sur des discours masculinistes. Dans ce cas, le fait d’enchaîner les partenaires continue d’être très valorisé. Et le repoussoir ultime, c’est le puceau.
VC : Je n’entends pas trop de discours masculinistes dans les classes. Peut-être que certains le cachent, mais il y a une conscience que ce n’est pas audible sans anonymat qui protège.
L’hétérosexualité est la norme mais existe-t-il une conscience plus accrue de la diversité des identités de genre ou sexuelles ?
CD : Il faut nuancer selon l’âge, le milieu social et l’endroit où l’on vit. Un lycée rural, un autre de banlieue et un très urbain ont été comparés dans une enquête. Elle a montré que le discours dans le lycée urbain était très ouvert mais dans les faits, il n’y avait pas deux garçons qui se tenaient la main. L’acceptation est donc plus dans les discours, et beaucoup plus à l’égard des filles. Pour ces dernières, il y a aussi un bond de l’ouverture des modèles qu’on ne retrouve pas chez les garçons. Il y a une ouverture mais pas pour tout le monde et il faut distinguer paroles et actes.
VC : J’ai l’impression que c’est plus facile pour les filles de vivre avec une orientation sexuelle différente. Lors de mes interventions, je vois, en revanche, beaucoup de garçons se tenir la cuisse ou le bras, s’avachir sur l’autre. Cela permet d’aller sur la question du consentement.
Le corps est donc beaucoup engagé chez les garçons, entre eux. Ils ne feraient pas ça avec une fille qui n’est pas leur partenaire. Mais l’homosexualité affichée est inenvisageable.
Quelle est la place des réseaux sociaux dans cette vie sentimentale et sexuelle
?
CD : On peut comprendre le vécu affectif et sentimental des adolescents sans penser réseaux sociaux mais cela reste très important, les deux sont articulés. Auparavant le flirte se faisait en boom et quand on rentrait, on avaitun téléphone à fil. C’était minuté et ça n’envahissait pas l’espace psychique, mental et temporel. La différence avec le crush
se fait notamment dans la place qu’il prend. Les risques addictifs, soulignés dans les études sur lesréseaux sociaux, se retrouvent aussi quand le crush se déploie sur ces mêmes réseaux, avec l’idée d’enquêter sur la personne.
Plus inquiétant, j’ai récemment entendu parler d’une application qui, à partir de photos du
crush permettait d’obtenir des images dénudées grâce à l’intelligence artificielle. Le but n’est pas d’aller dans la panique morale. Mais il y a des dérives qui sont à interroger, sur ce domaine comme sur d’autres.
VC : Il y a en effet cette dimension importante des médiums technologiques dans le déploiement des relations affectives. Notre génération et la suivante ont certaines choses en commun et d’autres différentes. Ils ont des termes qu’on ne connaît pas, des techniques. Pour nous, aimer trois photos sur Instagram permettait de manifester son intérêt. Pour eux ce sont sûrement d’autres codes.
Camille BOUZA.